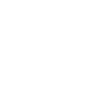Maid/Pour vous servir/Dans la peau d’une domestique anglaise
Trois livres, parmi d’autres, ont été écrits pour témoigner de la vie de domestique, d’employée de maison, de bonne à tout faire, de femme de ménage. Ils ont en commun de parler de gens assez aisés pour avoir une ou deux personnes à leur service mais pas assez riches pour avoir toute une armée de domestiques.
« Dans la peau d’une domestique anglaise, et autres immersions d’une journaliste américaine dans le Londres victorien* », a été écrit par Elizabeth L. Banks (1872-1938) d’après sa propre expérience en 1893 et à partir d’articles parus dans The Weekly Sun sous la rubrique « In Cap and Apron » (en bonnet et tablier). Pour le magazine The Illustrated English Magazine, Banks endosserait également le rôle de balayeuse de rue et de bouquetière, un métier disparu (si l’on excepte les ventes de muguet à la sauvette) et méconnu (à part dans le pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, devenue au cinéma My Fair Lady avec Audrey Hepburn dans le rôle de la bouquetière à l’horrible accent cockney).
Elle a également écrit un texte très drôle et assez cynique sur les riches Américaines qui viennent chercher un mari titré (mais fauché) en Angleterre et, au passage, s’acheter une généalogie prestigieuse – et totalement fausse – : « La toute-puissance du dollar dans la haute société londonienne« .

Banks, dotée d’une personnalité affirmée qui ne cède à aucune idée toute faite, commençait par prendre note d’un préjugé ( le linge lavé hors de chez soi pouvait donner des maladies, les bouquetières étaient malhonnêtes) avant de décortiquer la réalité entourant ce préjugé.
Les conditions de travail des blanchisseuses qu’elle étudie brièvement étaient très dures : les jeunes filles commençaient dès l’âge de 12 ans et travaillaient de 6 heures du matin à 7 heures du soir. Mais celles des domestiques n’étaient pas plus faciles: de nombreuses heures de travail, peu de congés, un logement étriqué et souvent insalubre (les fameuses « chambres de bonne »), aucune intimité (les patronnes ne se gênaient pas pour fouiller dans leurs affaires), des employeuses le plus souvent méfiantes et pingres. Banks, qui s’était renommée Barrows pour les agences de placement, teste plusieurs maisons pour « ‘entrer en condition ». Elle n’occupe jamais la place de cuisinière qui demande des talents particuliers alors qu’on ne s’inquiète jamais vraiment de ses compétences ménagères. Dans la plupart, il n’y avait pas assez de personnel pour entretenir une grande maison ce qui donne une quantité énorme de travail et, de surcroit, la nourriture était chiche (« un petit déjeuner ne consistant qu’en café et tartines beurrées n’est pas suffisant pour une domestique »).

Banks exprime à plusieurs reprises l’idée qu’il faudrait mettre en place une formation gratuite pour ne pas être « la honte de la profession ». Selon elle, de nombreuses jeunes employées sont inaptes aux tâches ménagères, manquent de bon sens et n’ont aucune moralité. Elle semble penser que plutôt que d’être couturières, employées de bureau ou d’usine pour garder leur « liberté » (les guillemets sont de l’auteure qui ajoute : »leur liberté consiste à mourir de faim »), certaines feraient mieux d’exercer leurs talents ménagers comme domestiques. D’autres encore vivent chez leurs parents en attendant un mari, mari qui n’arrive pas car « il n’y a apparemment pas assez de maris pour tout le monde en Angleterre »….
Elizabeth Banks suggère même que pour des jeunes femmes d’un bon niveau et de bonne famille, correctement formées, le travail « dans une demeure dotée de tout le confort de la vie moderne n’a rien d’une corvée ». Elle est en faveur de l’installation de monte-plats entre les sous-sols et les étages et d’arrivées d’eau chaude et froide (et oui, il faut se rappeler qu’on portait encore des seaux d’eau pour les bains, la toilette, la vaisselle, le lavage des sols..), ainsi qu’un chauffage au gaz pour ne plus avoir à transporter de lourds et salissants seaux de charbon).
Evidemment chacune doit savoir rester à sa place. Une employée n’est pas une « fille » pour sa patronne qui ne doit pas non prétendre à être sa « mère ». Banks elle-même au moment de recruter une employée de maison qui voulait (exigeait) de devenir un « membre de la famille », a dû lui expliquer qu’elle devrait servir à table et non s’asseoir avec les invités. Il s’agit « d’une convention professionnelle entre employeur et employé », rien de plus. Même si l’employée est instruite, voire davantage que sa patronne, elle n’est pas une amie pour cette dernière.
Le port du bonnet et du tablier?
L’usage de l’inévitable « Madame est servie »?
Banks n’y voit pas d’inconvénient pourvu qu’il y ait un respect mutuel.
Ce témoignage fort intéressant, qui ne tombe pas dans le larmoyant et fait plutôt preuve d’un solide pragmatisme, trouve un écho dans deux livres plus récents.
« Pour vous servir« , roman de Véronique Mougin** est une description narquoise de patrons de la bourgeoisie aisée qui font appel à une gouvernante et à son mari, des gens assez aisés pour avoir deux personnes à demeure. « Mes patrons me faisaient penser à ces délicieux gâteaux à la framboise qui dissimulent un coeur de citron acidulé. Ils étaient à la fois extrêmement bienveillants et légèrement supérieures, parfaitement aimables et totalement convaincus de leur supériorité ». En un mot : condescendants. Tout est dans l’art, par exemple, de dire merci : le merci des patrons est fait de « trois quarts d’indifférence souriante, un quart de gratitude ». « C’est un « merci élégant » qui signifie « c’est normal ». »

Quant au couple à temps partiel, composé par un homme marié et sa secrétaire (pas mariée et pas avec lui en tout cas), l’emploi de personnel de maison sert au premier à compenser ses absences auprès de la seconde. Quand on n’est pas né riche, il est plus difficile, nous dit Mougin, d’avoir la classe et l’élégance naturelle que permet l’argent (« après deux ou trois générations à capitaliser, les riches se tiennent, élancés, minces et toniques, au-dessus de la mêlée »). Cette pauvre Monique a bien du mal à « rester lisse comme un bidet » comme l’exigeait Charles…
Et puis, « les pauvres ont des problèmes, les riches ont des angoisses », c’est le cas d’une autre Madame, perpétuellement épuisée par un emploi du temps remarquablement vide…
Je passe sur le « parler chic « , sur le « métier de femme de nanti » qui consiste, entre autres, à « savoir commander à des employés toujours présents, obéir à une mari toujours absent » (on pense aux livres de Nadine de Rothschild qui a écrit sur la question de manière assez franche) …
Le seul refuge du personnel : l’office. En principe les patrons n’y mettent pas les pieds. Dans le livre que Sophie des Déserts a consacré à Jean d’Ormesson (voir ici), elle mentionne que l’écrivain n’a jamais su où se trouvait la cuisine, ni la cave à vins. Bénéficiant de la fortune de sa femme, il a toujours été servi à table au rythme de « Monsieur désire? ».
Ce livre ironique est rafraichissant mais ne découragera sans doute personne de rêver d’avoir beaucoup beaucoup d’argent -et le mental qui va avec, distant, bienveillant, plein de l’assurance de mériter tout ça. Evidemment, l’idéal est d’avoir assez d’argent pour ne pas gérer en direct le petit personnel et déléguer cette tâche à un intendant….
Le plus récent est celui de Stephanie Land, Maid, le journal d’une mère célibataire***.
On plonge dans l’univers douloureux d’une jeune femme qui élève seule sa fille dans le système américain qui ne pardonne pas grand-chose. Elle aussi s’inscrit à une agence de placement. Elle vit dans la crainte perpétuelle du moindre caillou qui pourrait faire déraper toute sa vie en équilibre extrêmement précaire : que sa voiture tombe en panne, qu’elle ou sa fille tombent malades sans qu’elle puisse payer les soins que l’on sait très onéreux aux Etats-Unis, qu’elle ne puisse plus payer son petit logement.
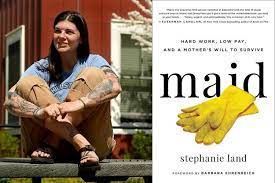
Ses membres de la famille ne lui sont d’aucune aide, le père de sa fille est fuyant et égoïste.
Ses employeurs qu’elle ne croise pas toujours sont parfois compatissants, le plus souvent indifférents ou méfiants.
Quand elle reçoit des bons alimentaires, les autres clients des magasins scrutent son chariot, prêts à critiquer ce qu’elle achète (elle se nourrit le plus souvent de beurre de cacahuètes), la soupçonnant en somme de vivre à leurs crochets. Les douleurs musculaires dont elle souffre sont constantes et handicapantes. Pour toucher la moindre aide, elle doit remplir des tonnes de formulaires, prendre des rendez-vous qui ne tiennent pas compte de son travail. On surveille la manière dont elle élève sa fille, on vérifie la propreté de son logement.
Toute sa vie en somme est sous contrainte et surveillance.
Pendant quelques temps, elle vit avec un homme et pense enfin pouvoir accéder à une vie normale avant de retomber dans la précarité et l’incertitude.
Et pourtant, Stephanie Land a, chevillée au corps, la volonté de s’en sortir.
Elle commence des études, écrit un blog (extraits) et veut devenir écrivain. Après avoir postulé et été reçue à l’Economic Hardship Reporting Project, organisation qui soutient le journalisme d’investigation sur les inégalités économiques, elle a pu enfin aller à l’université avec une bourse, obtenir un diplôme en anglais et écriture créative, publier des articles et finalement ce livre émouvant et terrible.
Comme l’écrit la préfacière, Barbara Ehrenreich, « si ce livre vous inspire, n’oubliez pas qu’il n’a tenu qu’à un fil qu’il ne soit pas écrit. Stephanie aurait pu succomber au désespoir ou à la fatigue ».

Sur la vie des domestiques au 19e, on peut lire l’excellent livre (déjà ancien) d’Anne Martin-Fugier : La place des bonnes : la domesticité féminine à Paris en 1900, réédité en format poche (Tempus).
Sur la vie quotidienne et les nombreuses corvées des domestiques, quelques sites (en anglais) qui détaillent les différents types de femmes de chambre, la tenue requise ou leur vie de tous les jours.
* Traduit par Hélène Colombeau et Hélène Hinfray, éditions Payot & Rivages, 2018. Le titre original est « Campaigns of curiosity. Journalistic Adventures of an American Girl in London ». Payot avait publié en 2013 « Les tribulations d’une cuisinière anglaise » de Margaret Powell (traduction : Hélène Hinfray), paru en Angleterre en 1968.
** Flammarion, 2015
*** Editions Globe, traduit par Christel Gaillard-Paris. Titre original « Maid, hard work, low pay and a mother’s will to survive ».
Tags In
Laisser un commentaire Annuler la réponse.
 Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
- Bernard Buffet, le premier amour de Pierre Bergé 29 décembre 2024
- Vous jouez encore à la poupée? 27 décembre 2024
- L’équilibre, c’est quoi pour vous? 13 décembre 2024