Robert Goolrick. Féroces.
Il me semble l’avoir déjà écrit : ma famille, mes parent, mon milieu familial n’ont pas été idéals, ni sereins, ni équilibrés. Beaucoup de violence, de cris, d’angoisse, de folie, de peur extrême parfois.
C’est assez fréquent, beaucoup plus qu’on ne le pense, d’avoir des parents dérangés, parfois juste l’un, parfois les deux, quand le couple est toxique, comme dans le livre de Delphine de Vigan ou ceux de Lionel Duroy. Simplement il arrive qu’on s’en sorte, aux prix de quelques errances, d’une distance, d’une dureté ou d’une instabilité.
Ce que raconte Robert Goolrick (1948-2022) dans Féroces (The End of the World as we know it : scenes from a life, Etats-Unis, 2007. Anne Carrière, 2010, traduction par Marie de Prémonville) est extraordinairement douloureux.

C’est un livre terrible, qui laisse, une fois qu’on l’a fermé, le souffle coupé.
Le livre commence par ces lignes : « Mon père est mort parce qu’il buvait trop. Six ans auparavant, ma mère était morte parce qu’elle buvait trop ».
Un peu plus loin : « Je croyais que je sauterais de joie, le jour où mon père mourrait. Je croyais que tout le poids du monde s’envolerait de mes épaules. Au lieu de quoi, j’étais submergé de chagrin ».
Voilà le début d’un récit qui parle de gens qui n’ont peut-être jamais aimé leurs enfants, ce fils-là en tout cas (il avait un frère et une soeur), pas plus que sa grand-mère paternelle ne l’aimait cet enfant. Non seulement, on ne l’aimait pas, mais on essayait de le rabaisser.
Il y a aussi la tante Dodo, attardée, le frère qui fait un anévrisme et dans la même chambre d’hôpital que ce dernier, un jeune homme, « beau comme un dieu grec », comme Elvis Presley, à qui était arrivé l’accident le plus grotesque jamais décrit dans un livre : lors d’un accident de moto, le réservoir de l’enfin lui était remonté dans le rectum et il y avait explosé (je sais qu’au moins un motard me lit de temps à autre, j’espère que les motos ont aujourd’hui des normes anti-éjection de réservoir…). « Il était beau et endormi ».
Et puis, on repart vers l’enfance, vers un monde de cocktails « faits maison » lors de soirées où les couples se reçoivent à tour de rôle et mélangent les alcools extraits d’un meuble spécial en utilisant des shakers, des cuillères à cocktail, des maillets à glace, des timbales gravées, des seaux à glace en argent, pour produire des Grasshopper, des Blue Monday, des Highball, des Side-Car et bien d’autres…
Les épouses se confectionnaient des robes chics, se faisaient des coiffures sophistiquées à grands coups de laque, d’épingles, de bigoudis.
L’argent n’entrait pas en ligne de compte. C’était l’allure qui comptait.
Les parents de ce petit garçon étaient drôles, pleins de charme, beaux et minces, élégants et recherchés de tous. « Mon père et ma mère présentaient au monde une image parfaite, celle d’un jeune couple heureux, spirituel et charmant, éperdument amoureux et qui ne faisait rien d’autre que s’amuser. Comme l’écrit Goolrick, une famille « centrée sur les parents, plus exactement centrée sur l’heure du cocktail et du dîner ».
Bien sûr, la vérité n’était pas tout à fait dans l’image parfaite. Sa mère ne travaillait pas et se gavait d’antidépresseurs. Ses parents se disputaient quand ils n’étaient pas en représentation.
Les enfants en avaient peur. Rien ne pouvait satisfaire leurs parents qui, jamais, ne remerciaient pour les cadeaux, jamais ne faisaient de compliments. Coincés entre une mère « aux accès de fureur et tyrannie » imprévisibles et un père figé dans une posture « d’indignation vertueuse ».
Les chapitres se succèdent, dans un ordre qui n’est pas chronologique : le passage de l’auteur en hôpital psychiatrique, les épisodes de harcèlement à l’école, ses tentatives de suicide, l’institutrice autoritaire qui apprend aux élèves comment faire du beurre avec de la crème fraîche épaisse et un bocal bien fermé (intéressant).
Arrive, comme une bombe, une scène atroce, véritablement atroce, et ses conséquences encore plus atroces.
Quelques pages avant la fin, dans un chapitre bouleversant de beauté et de fragilité, Goolrick résume cette enfance bancale, ratée et maudite et évoque l’amour qu’on a pour ses parents, malgré tout.
« Lorsqu’on ne reçoit pas d’amour de ceux qui sont censés nous aimer, on ne cesse jamais de le rechercher… On le cherche, c’est une certitude. Et on ne le trouve jamais. On n’en trouve jamais la moindre trace ».
Depuis L’année de la pensée magique (The Year of Magical Thinking, 2005. Grasset 2007, traduit par Pierre Demarty), de Joan Didion (1934-2021), je n’avais pas lu de livre aussi bouleversant.
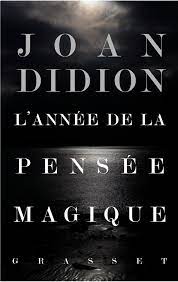
Voir aussi l’analyse de DaSola plus ancienne que la mienne
Tags In
4 Comments
Laisser un commentaire Annuler la réponse.
 Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
- Bernard Buffet, le premier amour de Pierre Bergé 29 décembre 2024
- Vous jouez encore à la poupée? 27 décembre 2024
- L’équilibre, c’est quoi pour vous? 13 décembre 2024
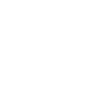

.Les traumas de l’enfance et les relations familiales bancales font couler beaucoup d’encre. Nous ne sommes pas sure de vouloir pénétrer ces univers déprimants.
C’est un livre magnifique qui offre tout autant une vision lumineuse que sombre de la vie familiale. Ni geignard, ni ordinaire.
Bonsoir Colette du Net, c’est un livre assez inoubliable (pour ma part lu et chroniqué en 2011) surtout de la part d’un Américain qui raconte tout en nous épargnant rien. Un grand livre. http://dasola.canalblog.com/archives/2011/02/08/20031502.html Bonne soirée.
Merci pour ce commentaire et ce billet que je n’avais pas vu